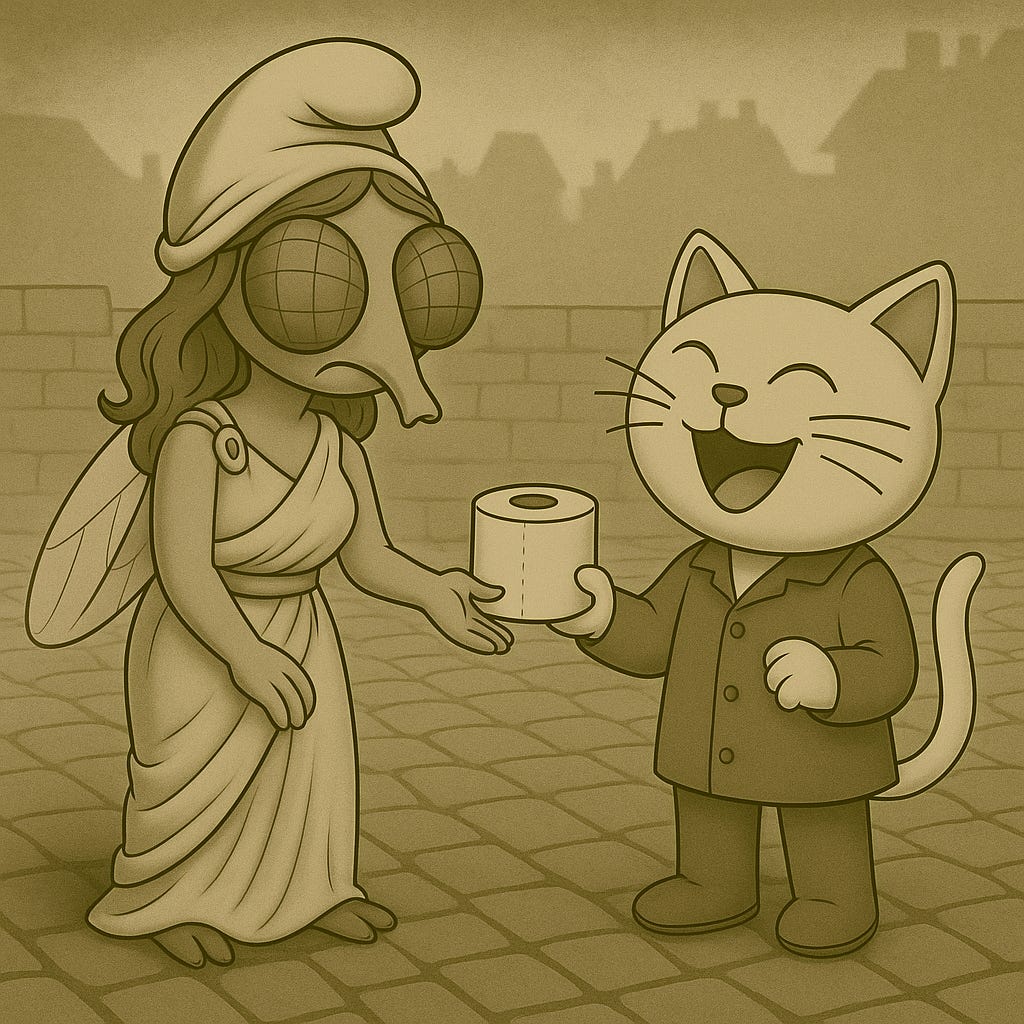🫵 Le spectacle de l’humiliation : quand le pouvoir exige sa mise en scène
⏩ Écoutez cet article en version audio 👇
Note liminaire de Christine
Cet article constitue le deuxième volet d’un triptyque consacré aux formes contemporaines du pouvoir.
Après le portrait de Raphaël Graven ou le reflet d'une société en faillite humaine, figure emblématique d’un certain type d’hommes qui prospèrent dans l’ombre des institutions, il s’agit ici de déplacer le regard : non plus sur l’individu, mais sur la scène.
Car le pouvoir ne se contente pas d’agir : il exige sa mise en scène. Et parmi ses rituels favoris, celui de l’humiliation occupe une place centrale.
À lire de préférence avec Wait and See de Saint Motel en fond sonore. Parce qu’il y a toujours, dans le spectacle de l’humiliation, une attente cynique : celle du prochain qui tombera.
Introduction
L’humiliation n’est jamais un simple accident, ni une maladresse individuelle. Elle est pensée, orchestrée, et surtout rendue visible. Dans les régimes autoritaires comme dans les démocraties usées, elle s’impose comme un instrument privilégié : non seulement pour briser, mais pour montrer qu’on brise.
Une sanction discrète peut suffire à punir. Mais une humiliation doit être publique pour avoir valeur politique.
🐾 #LesMaximesDeDuchesse
« Dans les régimes autoritaires comme dans les démocraties au bout du rouleau, une humiliation n’a de valeur politique que sur le papier hygiénique de la place publique. »
— Duchesse
Le rituel de l’humiliation
L’humiliation n’est pas une action ponctuelle. On voudrait la faire passer pour une blague de mauvais goût ou pour bizutage. En réalité elle est un rituel.
Elle obéit à des codes : la répétition, la disproportion, l’insistance sur les détails dérisoires. Comme dans un cérémonial ancien, chaque geste rappelle à l’humilié sa position subalterne.
Le guichet administratif où l’on renvoie un dossier pour une signature oubliée, l’audience où l’accusé est sermonné comme un enfant devant un amphithéâtre : autant de déclinaisons modernes du pilori.
Les sociétés médiévales avaient leurs piloris, leurs expositions publiques.
Aujourd’hui, la logique demeure : la mise en scène d’une soumission, qu’elle soit réelle ou fabriquée — pensons au kompromat, cet art de salir pour mieux tenir — alimente la machine du pouvoir.
Le public et ses rôles
Un spectacle suppose des spectateurs. Dans le théâtre de l’humiliation, le public est multiple :
Les complices, qui se réjouissent du sort réservé à l’autre.
Les indifférents, qui se taisent et deviennent ainsi témoins muets.
Les intimidés, qui comprennent que ce spectacle vaut avertissement.
L’humiliation est un spectacle low-cost : il ne demande aucun décor, seulement un corps offert aux regards.
Le pouvoir gagne sur tous les plans : il nourrit la peur, il entretient la passivité, et il flatte les pulsions les plus médiocres.
🐾 #LesMaximesDeDuchesse
« Panem et circenses ! L'Empire romain disait « du pain et des jeux et le peuple sera content. » »
— Duchesse
Le refus de jouer le rôle
Mais ce rituel peut être brisé. Il suffit parfois d’un geste simple : refuser de jouer le rôle qu’on attend de soi.
Ne pas baisser les yeux. Ne pas sourire. Ne pas présenter d’excuses qui valident la scène.
🐾 #LesMaximesDeDuchesse
« Le sourire qu’on exige de l’humilié n’est pas un signe de paix. C’est une signature au bas de sa propre reddition. »
— Duchesse
Résister, c’est aussi refuser de participer à la dramaturgie imposée. Car une humiliation qui n’est pas jouée cesse d’être un spectacle : elle devient une violence nue, que le pouvoir a plus de mal à justifier.
Le silence ou la raideur du corps, dans ces moments, valent parfois plus qu’un discours. Car ils déjouent l’essentiel : la jouissance du bourreau de voir sa victime consentir.
Conclusion
Après Raphaël Graven, incarnation individuelle d’un type d’homme, voici la scène qui permet à ces figures de prospérer : celle de l’humiliation orchestrée.
Le triptyque continue. Le troisième volet viendra refermer ce cycle en élargissant encore le regard : non plus seulement sur des figures ou des rituels, mais sur l’architecture globale d’un pouvoir qui ne connaît plus de contrepoids.
📢 Suivez-moi sur les réseaux :
📌 Instagram 📌 Twitter (X) 📌 Youtube 📌 Mon livre 📌 Parce que je ne vis ni d'amour, ni d'eau fraîche